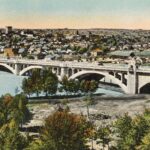Dans un revirement surprenant qui fait souffler un vent de soulagement sur la communauté anglophone, l’Office québécois de la langue française (OQLF) a reculé dans son différend avec un pub montréalais bien-aimé. Le Burgundy Lion, établissement emblématique du quartier de la Petite-Bourgogne depuis 16 ans, conservera son enseigne extérieure uniquement en anglais après avoir fait face à d’éventuelles amendes en vertu des strictes lois linguistiques du Québec.
« C’est comme si nous avions gagné une petite bataille dans une guerre beaucoup plus vaste, » m’a confié Paul Desbaillets, copropriétaire du Groupe Burgundy Lion, lors d’une visite au pub hier. L’intérieur chaleureux bourdonnait du mélange habituel de conversations en anglais et en français alors que les habitués célébraient la nouvelle. « Cet endroit fait partie du tissu montréalais depuis 2008. Notre nom est notre identité. »
La controverse a commencé lorsque l’OQLF a informé le pub que son enseigne extérieure uniquement en anglais contrevenait à la loi 96, la loi linguistique renforcée de la province. Cette législation exige que les entreprises affichent le français de manière prédominante sur toute signalisation publique, avec un texte en français au moins deux fois plus grand que les autres langues.
Mais après un important tollé public et l’attention des médias, l’OQLF a émis un communiqué reconnaissant que le nom du pub devrait être considéré comme une marque de commerce, l’exemptant ainsi de certaines exigences de la loi.
« C’est comme ça que le bon sens devrait fonctionner, » a déclaré Louis Bélanger, un client de longue date sirotant une pinte au bar. « Je suis Québécois, fier de ma langue, mais cet endroit s’appelle The Burgundy Lion – changer ça ne protège pas le français, ça efface simplement son caractère. »
L’OQLF a précisé que si le pub peut conserver son nom tel quel, les autres éléments informatifs sur la signalisation extérieure doivent toujours se conformer à la loi en mettant le français en évidence.
Les différends linguistiques à Montréal se sont intensifiés depuis l’entrée en vigueur de la loi 96 en 2022. Cette législation a élargi les exigences linguistiques pour les entreprises et réduit le seuil pour le statut bilingue dans les municipalités. Les critiques soutiennent que ces mesures affectent de manière disproportionnée les communautés historiquement anglophones et les commerces tenus par des immigrants.
« Nous constatons une anxiété croissante dans toute la communauté des petites entreprises montréalaises, » explique Christine Hogg, directrice de l’Association pour les droits des anglophones du Québec. « De nombreux propriétaires ne s’opposent pas à l’affichage en français, mais ils s’inquiètent de préserver leurs identités culturelles et leur patrimoine dans un cadre réglementaire de plus en plus strict. »
Le cas du Burgundy Lion représente ce que beaucoup appellent une rare victoire au milieu de tensions croissantes. Le mois dernier, un café italien dans le Mile End a fait face à des défis similaires concernant son menu, tandis qu’un restaurant grec dans Parc-Extension a été cité pour des publications en anglais sur les réseaux sociaux.
Le premier ministre du Québec, François Legault, a défendu la législation comme étant nécessaire pour préserver le français en Amérique du Nord, où il reste une langue minoritaire. « Protéger le français ne signifie pas éliminer l’anglais, » a déclaré Legault lors d’une conférence de presse la semaine dernière. « Cela signifie s’assurer que le français demeure la langue commune de la société québécoise. »
En me promenant dans la Petite-Bourgogne hier après-midi, j’ai remarqué le mélange distinctif de langues et de cultures qui rend Montréal unique. Les conversations passaient sans effort du français à l’anglais alors que les gens se déplaçaient entre les boutiques, les restaurants et le Marché Atwater.
« Le charme de Montréal vient de cet équilibre, » a fait remarquer Sophie Tremblay, une enseignante de français que j’ai rencontrée alors qu’elle déjeunait sur la terrasse du Burgundy Lion. « Nous devons protéger le français, absolument. Mais pas au détriment du caractère multiculturel de la ville qui fait ce que nous sommes. »
Pour Desbaillets et son équipe, la victoire a un goût doux-amer. « Nous sommes soulagés, mais inquiets pour d’autres entreprises qui mènent encore des batailles similaires, » a-t-il déclaré. « Ça n’aurait pas dû être un combat dès le départ. »
Le Burgundy Lion représente depuis longtemps le type d’établissement qui fait le pont entre les communautés linguistiques de Montréal. N’importe quel soir, vous entendrez des conversations alternant entre le français et l’anglais, avec des menus disponibles dans les deux langues et un personnel passant sans effort de l’une à l’autre.
Alors que le Québec continue de naviguer sur le terrain complexe de la protection linguistique et de la diversité culturelle, des cas comme celui du Burgundy Lion mettent en lumière les défis de la mise en œuvre d’une législation large dans une ville connue pour son tissu multiculturel.
« Au bout du compte, nous sommes tous Montréalais, » a réfléchi Desbaillets alors que nous observions la foule diverse profitant de l’atmosphère du pub. « La langue est importante – toutes nos langues sont importantes. Mais le caractère et l’histoire qui rendent cette ville spéciale le sont tout autant. »