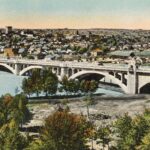Alors que le premier ministre du Québec François Legault accueillait cette semaine les gouverneurs et les chefs d’entreprises à Québec, le cadre élégant de notre capitale historique est devenu plus qu’un simple décor – il s’est transformé en scène pour des conversations cruciales sur l’avenir économique liant le Canada et les États-Unis.
Ayant couvert de nombreux sommets économiques tout au long de ma carrière, je peux vous dire que cette rencontre avait un poids particulier. La Conférence des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et des premiers ministres de l’Est du Canada a réuni des leaders régionaux à un moment où les tensions commerciales entre nos nations ont atteint des niveaux préoccupants.
En parcourant les couloirs du pouvoir pendant le sommet, j’ai observé comment le premier ministre Legault s’est positionné à la fois comme hôte et défenseur. « Nous devons travailler ensemble pour convaincre Washington et Ottawa de l’importance de notre relation économique », a-t-il déclaré aux leaders assemblés, ses paroles portant à la fois urgence et conviction.
Le moment ne pourrait être plus significatif. Le mois dernier, l’administration Biden a imposé un tarif de 100 % sur l’acier canadien utilisé dans les projets d’infrastructure publique. Cette décision a envoyé des ondes de choc à travers le secteur manufacturier québécois, où des milliers d’emplois dépendent directement du commerce transfrontalier.
Michel Leblanc, président de la Chambre de commerce de Montréal, m’a partagé son point de vue entre les sessions. « Ces tarifs créent une incertitude immédiate pour les entreprises québécoises qui ont bâti leurs opérations autour de chaînes d’approvisionnement intégrées », a-t-il expliqué. « Quand des décisions politiques perturbent des décennies d’intégration économique, ce sont les travailleurs et les communautés des deux côtés qui finissent par en payer le prix. »
Les chiffres racontent une histoire convaincante sur ce qui est en jeu. Le Québec exporte plus de 65 milliards de dollars en biens et services vers les États-Unis annuellement, représentant environ 70 % de nos exportations totales. Derrière ces chiffres, il y a des personnes réelles – près de 300 000 Québécois dont les moyens de subsistance dépendent directement de cette relation.
Le gouverneur du Vermont, Phil Scott, a reconnu cette réalité lors de son allocution. « Nos économies ne sont pas seulement connectées – elles sont profondément entrelacées », a-t-il noté. « Quand nous plaçons des barrières entre nous, nous n’affectons pas seulement des statistiques commerciales; nous affectons des familles et des communautés qui ont bâti leur avenir autour de ce partenariat. »
En tant que journaliste qui a couvert le paysage économique diversifié de Montréal depuis plus de quinze ans, j’ai été témoin de première main de comment même de petits changements dans la politique commerciale peuvent se répercuter dans nos communautés locales. Le fabricant d’aluminium au Saguenay, le fournisseur aérospatial à Saint-Laurent, l’entreprise technologique du Mile End – tous existent dans un écosystème économique qui transcende la frontière.
L’approche du premier ministre Legault lors du sommet reflétait cette complexité. Il a équilibré une défense ferme des intérêts du Québec avec la reconnaissance des préoccupations américaines, particulièrement concernant la concurrence de la Chine. « Nous comprenons les préoccupations légitimes concernant la concurrence déloyale », a-t-il reconnu. « Mais la solution ne peut pas être de traiter vos alliés et partenaires commerciaux les plus proches comme faisant partie du problème. »
La gouverneure du Massachusetts, Maura Healey, a souligné les avantages pratiques de la collaboration plutôt que la confrontation. « Quand nous regardons les défis auxquels l’Amérique du Nord fait face – du changement climatique à la sécurité énergétique en passant par la transformation technologique – nous sommes plus forts en les affrontant en tant que partenaires plutôt qu’en tant que concurrents », a-t-elle déclaré lors de la session de clôture.
Au-delà des discussions formelles, j’ai remarqué quelque chose d’également important se produisant dans les couloirs et pendant les pauses-café. Des représentants d’entreprises des deux côtés de la frontière étaient engagés dans des conversations intenses, échangeant des cartes de visite et planifiant des réunions de suivi. Cette diplomatie économique de terrain s’avère souvent aussi précieuse que les communiqués officiels.
Robert Tessier, ancien président du conseil de la Caisse de dépôt et placement du Québec, a parfaitement résumé la situation lorsque je lui ai parlé après les principales délibérations. « Les tensions commerciales font les manchettes, mais ce qui soutient notre relation, ce sont les milliers d’interactions quotidiennes entre les entreprises et les personnes qui comprennent que nous faisons tous partie d’une communauté économique partagée. »
Le sommet s’est conclu avec des engagements pour améliorer la coopération régionale sur les initiatives d’énergie propre, l’infrastructure de transport et le développement de la main-d’œuvre – tous des domaines cruciaux où la collaboration transfrontalière multiplie les avantages pour les citoyens des deux côtés.
En réfléchissant aux événements pendant mon retour à Montréal, ce qui me frappe le plus est comment cette relation internationale complexe devient profondément personnelle pour les communautés à travers notre province. Quand nous parlons des relations commerciales entre les États-Unis et le Canada, nous parlons vraiment de la sécurité économique de nos voisins, de nos entreprises locales et, ultimement, de la vitalité de notre identité régionale partagée.
La voie à suivre reste difficile. Avec les élections présidentielles qui approchent aux États-Unis et les pressions croissantes de la concurrence mondiale, la relation commerciale stable que nous avons longtemps tenue pour acquise nécessite un engagement renouvelé et de la créativité de la part des leaders à tous les niveaux.
Pour les Montréalais et les Québécois qui suivent ces développements, le message de Québec est clair : notre avenir économique reste profondément connecté à nos voisins du sud, et cultiver cette relation exige à la fois vigilance et vision.