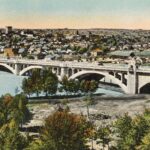J’ai été témoin hier d’une scène poignante qui en dit long sur la lutte continue de notre ville pour l’accessibilité et la dignité. Alors que la pluie tombait sur le centre-ville de Montréal, plus de 60 militants pour les droits des personnes handicapées se sont rassemblés pour ce qu’ils ont appelé une « marche funèbre » – une puissante manifestation symbolique soulignant la « mort de l’autonomie » que de nombreuses personnes handicapées affrontent quotidiennement.
La manifestation, organisée par le RAPLIQ (Regroupement des activistes pour l’inclusion au Québec), a lentement progressé le long de la rue Sainte-Catherine. Les participants, vêtus de noir, certains portant des cercueils et des pierres tombales factices, ont créé une métaphore visuelle saisissante pour leur message.
« Nous enterrons notre autonomie aujourd’hui parce que le gouvernement continue d’ignorer nos droits fondamentaux de circuler librement dans notre propre ville, » a expliqué Marie-Eve Veilleux, militante de longue date du RAPLIQ que j’ai interviewée plusieurs fois au cours de mes années à couvrir le mouvement pour l’accessibilité à Montréal.
Le choix de la date n’était pas une coïncidence. Cette manifestation marquait le 15e anniversaire de l’adoption par le Québec d’une législation sur l’accessibilité que de nombreux militants décrivent comme « sans dents » et « inefficace ». La loi québécoise de 2004 sur le handicap manque de mécanismes d’application et d’échéanciers concrets, créant ce que les manifestants appellent un état perpétuel de « planification sans action ».
Ce qui m’a le plus frappé en regardant le cortège était la diversité des participants. J’ai aperçu des utilisateurs de fauteuils roulants, des personnes ayant des déficiences visuelles utilisant des cannes blanches, des familles avec des enfants ayant des handicaps développementaux, et de nombreux alliés sans handicap marchant en solidarité.
Plusieurs participants ont partagé des histoires qui illustrent leur réalité quotidienne. Michel Dupuis, un utilisateur de fauteuil roulant de Rosemont, a décrit comment il doit systématiquement planifier ses déplacements plusieurs jours à l’avance, en recherchant quelles stations de métro ont des ascenseurs et quels commerces il peut réellement fréquenter.
« Je ne peux pas spontanément retrouver des amis pour dîner ou magasiner comme tout le monde, » m’a confié Dupuis. « C’est ce que nous entendons par la mort de l’autonomie – perdre la liberté de faire des choix fondamentaux. »
Les statistiques qui appuient leur frustration sont frappantes. Selon la Société de transport de Montréal (STM), seulement 19 des 68 stations de métro de Montréal disposent actuellement d’ascenseurs – environ 28 pour cent. Ce chiffre est nettement inférieur à celui d’autres villes canadiennes comme Toronto et Vancouver.
Au-delà du transport, les manifestants ont souligné le fait que de nombreux commerces restent inaccessibles malgré la législation existante. Une enquête de 2022 réalisée par le groupe québécois pour l’accessibilité Ex-aequo a révélé qu’environ 43 pour cent des restaurants et commerces de détail du centre de Montréal ont encore des marches à l’entrée sans rampes ni accès alternatif.
La manifestation s’est terminée à la Place Émilie-Gamelin, où les organisateurs ont mis en scène une cérémonie funèbre symbolique. Des leaders communautaires ont lu des témoignages de personnes handicapées qui ont vécu de la discrimination ou de l’exclusion.
« Ce que nous pleurons aujourd’hui, c’est l’échec constant de notre société à reconnaître notre humanité, » a déclaré Laurent Morissette, président du RAPLIQ. « L’accessibilité n’est pas une charité – c’est un droit fondamental. »
J’ai remarqué plusieurs conseillers municipaux qui observaient la manifestation, dont Dominique Ollivier, qui préside le comité exécutif de Montréal. Lorsqu’on lui a demandé de commenter, Ollivier a reconnu les lacunes de la ville, mais a souligné le Plan d’accessibilité de Montréal récemment adopté, qui promet d’accélérer les améliorations des infrastructures publiques.
« Nous comprenons la frustration et nous nous engageons à faire mieux, » a déclaré Ollivier. « Le nouveau plan comprend des échéanciers obligatoires et des allocations de financement spécifiques. »
Cependant, beaucoup de manifestants sont restés sceptiques. Le bureau du ministre québécois responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, a fourni une déclaration soulignant que 45 millions de dollars avaient été alloués aux initiatives d’accessibilité dans le plus récent budget provincial.
Mais pour des manifestants comme Sophie Villeneuve, qui utilise un fauteuil roulant motorisé, les promesses passées se sont rarement traduites par des changements significatifs.
« J’entends ces engagements depuis toute ma vie d’adulte, » a confié Villeneuve. « Pendant ce temps, je ne peux toujours pas utiliser la plupart des stations de métro, entrer dans de nombreux magasins ou trouver un logement accessible sans un effort extraordinaire. »
En tant que personne qui couvre l’actualité montréalaise depuis plus d’une décennie, j’ai pu constater comment l’architecture unique de notre ville – avec ses emblématiques escaliers extérieurs et ses bâtiments historiques – présente de réels défis pour l’accessibilité. Pourtant, d’autres villes avec des infrastructures tout aussi historiques ont réalisé davantage de progrès.
Le message de la manifestation va au-delà des barrières physiques. Les participants ont également mis en lumière des problèmes comme la discrimination à l’emploi, les services de soutien inadéquats et l’isolement qui résulte de l’exclusion systémique.
Alors que la manifestation se dispersait, les organisateurs ont annoncé des plans pour des actions mensuelles jusqu’à ce que des progrès concrets soient réalisés. Leurs revendications immédiates comprennent la mise en œuvre de normes d’accessibilité avec des échéances claires et des pénalités en cas de non-conformité.
Observer des Montréalais handicapés lutter avec tant de passion pour leurs droits fondamentaux à participer à la vie urbaine m’a amené à réfléchir sur le type de communauté que nous voulons vraiment bâtir. La question n’est pas de savoir si nous pouvons créer un Montréal plus accessible – c’est de savoir si nous avons la volonté collective de le faire.