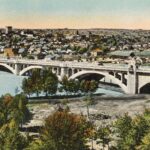Dans une réunion aux enjeux considérables qui pourrait redéfinir les relations entre Ottawa et les communautés des Premières Nations, le ministre des Finances Mark Carney rencontrera demain les chefs autochtones et les détenteurs de droits lors de ce que plusieurs considèrent comme un sommet décisif sur la législation des grands projets.
La rencontre, qui se tiendra au Centre Shaw au centre-ville d’Ottawa, survient dans un contexte de tensions croissantes concernant l’approche proposée par le gouvernement pour les grands projets d’infrastructure et de ressources affectant les territoires autochtones. Des sources proches des discussions m’indiquent que l’atmosphère est « prudemment optimiste, mais prête à des conversations franches ».
« Ce n’est pas qu’une simple consultation, » explique le Chef William Constant des Nations Signataires de Traités du Nord du Manitoba. « Nous venons à cette table en tant que partenaires égaux avec des droits constitutionnels qui doivent être respectés dans tout nouveau cadre législatif. »
Ce sommet fait suite à des mois de discussions préliminaires après que les Libéraux ont signalé leur intention de simplifier les processus d’approbation pour les infrastructures critiques tout en respectant les droits autochtones. Cet exercice d’équilibre s’est avéré difficile, plusieurs leaders des Premières Nations ayant exprimé des inquiétudes quant à savoir si la législation proposée honore véritablement les principes de consentement libre, préalable et éclairé établis dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.
Carney, chargé d’accélérer la croissance économique du Canada, a répété à maintes reprises que le respect des droits autochtones et le progrès économique ne sont pas des objectifs mutuellement exclusifs.
« Nous devons dépasser le faux choix entre développement économique et reconnaissance des droits autochtones, » a déclaré Carney lors d’un récent forum économique à l’Université Carleton. « La voie à suivre doit inclure les deux. »
En coulisses, j’ai appris que plusieurs points d’achoppement demeurent. L’Assemblée des Premières Nations a fait pression pour que la législation reconnaisse explicitement l’autorité des gouvernements autochtones d’approuver ou de rejeter des projets sur leurs territoires traditionnels. Les représentants du gouvernement ont été réticents à inclure un langage aussi définitif, préférant des termes comme « consultation significative » et « accommodement ».
La Cheffe Patricia Johnson de l’Alliance des Traités de l’Ouest m’a confié hier que ce sommet représente un moment critique. « Nous avons connu des décennies de promesses et de déceptions. Ce dont nous avons besoin maintenant, c’est une législation qui reconnaît véritablement notre autorité décisionnelle, pas seulement notre droit d’être consultés. »
Les enjeux ne pourraient être plus importants pour les deux parties. Le gouvernement fédéral a identifié plus de 70 milliards de dollars en projets potentiels d’infrastructure et de ressources qu’il considère essentiels pour la transition du Canada vers une économie à faibles émissions de carbone. Plusieurs de ces projets traverseraient des territoires autochtones traditionnels.
Pour les communautés des Premières Nations, cette législation représente une opportunité d’établir des paramètres clairs sur la façon dont leurs droits seront respectés dans les décisions économiques majeures affectant leurs terres et ressources.
« Il ne s’agit pas simplement de dire non aux projets, » explique Rebecca Tallman, juriste autochtone. « Il s’agit de s’assurer que les Premières Nations sont de véritables partenaires dans le développement qui se produit sur leurs territoires, avec des bénéfices qui reviennent aux communautés historiquement exclues. »
Les organisations environnementales surveillent également le processus de près. L’Association canadienne du droit de l’environnement a exhorté tant le gouvernement que les leaders des Premières Nations à s’assurer que tout nouveau cadre maintienne de solides protections environnementales parallèlement à la reconnaissance des droits autochtones.
La rencontre de demain inclura des représentants de toutes les principales organisations autochtones nationales ainsi que des chefs des régions où d’importants projets sont envisagés. Le format comprendra à la fois des sessions de dialogue ouvert et des groupes de travail plus restreints se concentrant sur des aspects spécifiques de la législation proposée.
Je rendrai compte des développements au fur et à mesure, mais plusieurs initiés ont indiqué que bien qu’un accord final ne soit pas attendu immédiatement, le gouvernement espère établir des principes clairs qui pourront guider l’élaboration de la législation avant le retour du Parlement en septembre.
En traversant le Marché By hier, j’ai croisé un haut fonctionnaire du gouvernement qui, sous couvert d’anonymat, a admis le défi à venir: « Nous essayons de trouver un équilibre très délicat. Tout le monde convient que le statu quo ne fonctionne pas, mais trouver le juste milieu qui respecte les droits tout en créant une certitude pour l’investissement n’est pas facile. »
En tant que journaliste couvrant les relations entre la Couronne et les Autochtones depuis plus de quinze ans, j’ai observé comment ces discussions ont évolué. Ce qui est différent maintenant, c’est le niveau de sophistication et de préparation juridique que les communautés autochtones apportent à la table. L’époque où la consultation signifiait simplement informer les communautés de décisions déjà prises est révolue.
Ce sommet survient quelques semaines après que la Cour suprême du Canada a rendu un jugement important affirmant les revendications de titre autochtone dans certaines parties de la Colombie-Britannique, une décision que de nombreux experts juridiques considèrent comme renforçant la position des Premières Nations dans ces négociations.
Pour les résidents d’Ottawa, l’issue de ces discussions pourrait avoir d’importantes implications locales. La région de la capitale nationale se trouve sur un territoire algonquin non cédé, et la Nation Anishinaabe Algonquine est devenue de plus en plus affirmative quant à ses droits concernant le développement dans la région.
Alors que je termine mes préparatifs pour couvrir le sommet de demain, je me rappelle ce que l’Aîné Joseph Commanda m’a dit lors d’un précédent reportage sur la réconciliation: « Le véritable progrès ne se mesure pas au nombre de réunions que nous avons, mais à la façon dont la relation entre nos peuples change fondamentalement. »
Le sommet de demain nous dira peut-être si cette relation évolue enfin de manière significative.