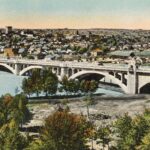Alors que Montréal se prépare à affronter une semaine pluvieuse, une tempête d’un autre genre se prépare dans le paysage politique québécois. Un nouveau sondage publié hier révèle une évolution des attitudes envers la tarification du carbone chez les Québécois, l’opposition grandissant dans les régions situées en dehors des grands centres urbains.
L’enquête, menée par Léger pour l’Institut du Québec, montre que 57 % des répondants des zones rurales et suburbaines s’opposent désormais au système de plafonnement et d’échange de la province, contre 42 % il y a seulement dix-huit mois. Cela marque un changement significatif dans une province longtemps considérée comme un chef de file des politiques climatiques en Amérique du Nord.
« Nous observons un fossé grandissant entre les zones urbaines et rurales concernant la politique climatique, » explique Catherine Moreau, analyste en politique environnementale à l’Université de Montréal. « Alors que le soutien reste relativement stable à Montréal et Québec, les régions périphériques s’inquiètent de plus en plus des impacts économiques. »
En me promenant au Marché Jean-Talon hier matin, j’ai remarqué que les conversations sur la hausse des coûts sont devenues aussi courantes que les discussions sur la météo. Vendeurs et acheteurs ont mentionné leurs préoccupations concernant l’inflation, plusieurs faisant spécifiquement référence à la tarification du carbone comme facteur contributif.
Martin Beauséjour, qui gère un étal familial de légumes, a partagé son point de vue : « Mes coûts de transport ont augmenté de près de 20 % en deux ans. Je comprends que nous devons lutter contre les changements climatiques, mais les petites entreprises peinent à absorber ces hausses. »
Le sondage suggère que les préoccupations économiques alimentent effectivement l’opposition. Parmi les répondants qui s’opposent à la tarification du carbone, 72 % ont cité les pressions sur le coût de la vie comme principale préoccupation, tandis que 65 % remettent en question l’efficacité du système pour réduire concrètement les émissions.
Le système de plafonnement et d’échange du Québec, lié à celui de la Californie depuis 2014, a été une pierre angulaire de la stratégie climatique de la province. Il oblige les grands émetteurs à acheter des droits pour leurs émissions de gaz à effet de serre, créant ainsi une incitation financière à réduire la pollution.
Le premier ministre François Legault a maintenu son soutien au système malgré une pression politique croissante. Lors d’une conférence de presse la semaine dernière, il a reconnu les préoccupations mais a insisté sur le fait que cette politique demeure essentielle : « Nous ne pouvons pas lutter contre les changements climatiques sans mettre un prix sur la pollution. Mais nous devons nous assurer que la transition est équitable et gérable pour tous les Québécois. »
L’évolution de l’opinion publique reflète des tendances observées ailleurs. Lors de ma couverture de la conférence COP28 l’année dernière, cette tension entre ambition climatique et réalité économique était évidente dans de nombreuses juridictions.
Les défenseurs de l’environnement restent préoccupés par d’éventuels revirements politiques. « Ce n’est pas le moment de reculer sur des solutions climatiques éprouvées, » soutient Sophie Laroche d’Équiterre. « Ce dont nous avons besoin, c’est une meilleure communication sur la façon dont les revenus de la tarification du carbone peuvent bénéficier aux communautés et un soutien plus ciblé pour les ménages vulnérables. »
Le sondage révèle également des tendances démographiques intéressantes. Le soutien à la tarification du carbone reste le plus fort chez les jeunes Québécois (18-34 ans) à 68 %, tandis que les plus de 55 ans affichent l’opposition la plus élevée à 54 %.
Après avoir couvert les mouvements environnementaux montréalais pendant plus d’une décennie, j’ai été témoin du flux et reflux du sentiment public. Ce qui ressort de ce dernier sondage n’est pas seulement l’opposition à la politique elle-même, mais le scepticisme quant à sa mise en œuvre.
« Les gens ne sont pas nécessairement contre l’action climatique, » note Daniel Bélanger, politologue à l’Université Laval. « Ils se demandent si l’approche actuelle distribue équitablement les coûts et les bénéfices. C’est un défi de mise en œuvre politique plus qu’un rejet des objectifs environnementaux. »
Le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec a lancé une nouvelle campagne d’information publique axée sur la façon dont les revenus de la tarification du carbone soutiennent des projets d’infrastructure verte dans toute la province. Reste à voir si ce message fera évoluer l’opinion publique.
Pour l’instant, alors que les Montréalais ajustent leurs parapluies contre la pluie printanière, beaucoup ajustent également leur budget familial en gardant un œil sur la hausse des coûts et les préoccupations environnementales. Le défi pour les décideurs sera de répondre aux deux simultanément – un exercice d’équilibre délicat dans une période de plus en plus polarisée.
Ce qui ressort clairement des données de sondage et des conversations dans les marchés et cafés montréalais, c’est que la conversation sur le climat au Québec a évolué. Il ne s’agit plus de savoir s’il faut agir, mais comment s’assurer que les politiques climatiques fonctionnent pour tous – en particulier pour ceux qui ressentent le plus durement la pression économique.