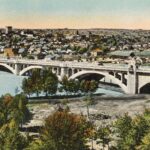Les tensions croissantes entre les chefs des Premières Nations et le gouvernement provincial de l’Ontario ont atteint un point critique hier lorsque des Chefs de toute la province se sont unis pour réclamer la démission immédiate de la ministre de l’Environnement, Andrea Khanjin. Rassemblés à Queen’s Park, des représentants de multiples communautés des Premières Nations ont accusé la ministre de manquer systématiquement au respect des droits de consultation autochtone sur les décisions environnementales majeures.
« Il ne s’agit pas simplement d’un projet ou d’une décision – c’est une question de mépris systématique pour nos droits issus de traités et notre rôle de gardiens de ces terres, » a expliqué la Chef Emily Wabano de la Première Nation de Matachewan lors de la conférence de presse. Son sentiment résonnait parmi tous les participants alors que les leaders détaillaient ce qu’ils décrivent comme un modèle troublant d’exclusion.
Au cœur du conflit se trouvent les modifications controversées aux processus d’évaluation environnementale, qui selon les chefs des Premières Nations, contournent efficacement une consultation autochtone significative. Ces changements, mis en œuvre plus tôt cette année, ont accéléré les délais d’approbation de plusieurs projets de développement des ressources dans le Nord de l’Ontario.
Le Chef William Sutherland de la Première Nation de Fort Albany a souligné des cas spécifiques où les connaissances écologiques traditionnelles semblaient être écartées au profit d’un développement accéléré. « Notre peuple vit en relation avec ces terres depuis des milliers d’années. Quand nous soulevons des préoccupations concernant la qualité de l’eau ou les modèles de migration de la faune, ce ne sont pas simplement des opinions – c’est un savoir générationnel qui mérite respect et considération. »
Le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs a publié une brève déclaration suite à la conférence de presse, défendant son bilan en matière de consultation et soulignant que « le gouvernement reste engagé à travailler en collaboration avec les communautés autochtones tout en équilibrant les besoins de développement économique à travers la province. »
Cependant, cette réponse n’a guère satisfait les chefs des Premières Nations qui invoquent la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et l’obligation constitutionnelle du Canada de mener des consultations significatives.
Couvrant les conflits de politique environnementale depuis près d’une décennie, je suis frappé par l’unité sans précédent parmi ces communautés des Premières Nations habituellement diverses. Des Chefs représentant tant les territoires visés par des traités que ceux non visés se tenaient côte à côte – un témoignage visuel puissant de la profondeur de ces préoccupations.
Le moment de cette confrontation est particulièrement remarquable, survenant quelques semaines seulement avant que la province ne présente sa stratégie révisée de gestion des ressources à long terme. Des sources proches de ces discussions m’indiquent que la stratégie inclura probablement d’importantes expansions des opérations minières et forestières dans des zones où s’opposent des revendications territoriales autochtones.
La professeure Sandra McKenzie, experte en droit environnemental de l’Université métropolitaine de Toronto, explique que le conflit représente plus que de simples désaccords procéduraux. « Ce dont nous sommes témoins est un choc fondamental entre différentes conceptions de l’intendance environnementale et de l’autorité décisionnelle, » a-t-elle noté lors de notre conversation après la conférence de presse.
La coalition des Premières Nations a donné au gouvernement provincial jusqu’à la fin du mois pour répondre à leurs préoccupations avant d’entreprendre des mesures supplémentaires, y compris d’éventuelles contestations juridiques et des actions directes sur les sites de développement proposés.
Le soutien du public à la position des Premières Nations semble substantiel. Un récent sondage de l’Alliance environnementale de l’Ontario a révélé que 68% des résidents provinciaux croient que les communautés autochtones devraient avoir plus d’autorité dans les décisions environnementales affectant leurs territoires traditionnels.
Le bureau du premier ministre Ford est resté notablement silencieux sur la demande spécifique de démission de la ministre Khanjin, bien que des sources gouvernementales suggèrent qu’une réunion de haut niveau entre les responsables provinciaux et les dirigeants des Premières Nations soit en cours d’organisation pour la semaine prochaine.
Alors que le quartier financier de Toronto se prépare à voir plusieurs sociétés de ressources publier leurs rapports trimestriels dans les prochains jours, les investisseurs surveillent attentivement cette situation. Les analystes de marché ont déjà noté une volatilité accrue des actions des entreprises ayant d’importants intérêts de développement dans les zones touchées par ces différends.
Pour les Ontariens ordinaires, ce conflit représente plus qu’un théâtre politique distant. Les résultats influenceront probablement tout, du développement futur des ressources aux normes de protection environnementale qui affectent la qualité de l’eau, la conservation des forêts et les stratégies d’adaptation au climat dans toute la province.
En traversant Allan Gardens après la conférence de presse, je ne pouvais m’empêcher de réfléchir à la façon dont ces tensions provinciales font écho à des luttes similaires qui se déroulent partout au Canada – chacune représentant une réconciliation complexe entre les droits autochtones, la protection environnementale et les aspirations économiques.
Les jours à venir révéleront si ce moment marque un tournant dans l’approche de l’Ontario envers les partenariats environnementaux autochtones ou s’il approfondit des divisions qui compliquent la gouvernance des ressources depuis des générations.