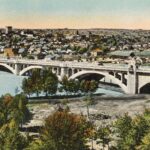Montréal est en pleine effervescence de discussions concernant la libération imminente du trafiquant de drogue condamné Jeffrey Robert Colegrove, qui sera libre le mois prochain malgré le refus de sa libération conditionnelle. Cette affaire met en lumière les complexités de notre système judiciaire et soulève d’importantes questions sur la réhabilitation et la sécurité publique dans notre communauté.
Colegrove, reconnu coupable de graves accusations de trafic de stupéfiants, sera libéré après avoir purgé les deux tiers de sa peine, bien que la Commission des libérations conditionnelles du Canada ait déterminé qu’il présente «un risque indu pour la société». Cette disposition de libération d’office, qui s’applique à la plupart des détenus fédéraux, a suscité l’inquiétude chez de nombreux Montréalais.
«La libération automatique après avoir purgé les deux tiers d’une peine vise à offrir une période de transition supervisée vers la société», explique Marie Beaulieu, professeure de justice pénale à l’Université de Montréal. «Cependant, des cas comme celui de Colegrove mettent en évidence la tension entre les exigences légales et les considérations de sécurité publique».
Les documents judiciaires révèlent que Colegrove a été arrêté en 2019 suite à une enquête de la GRC qui a mis au jour son implication dans un réseau sophistiqué de trafic de drogue s’étendant sur plusieurs provinces. L’enquête a révélé des liens avec des groupes du crime organisé opérant partout au Québec et en Ontario.
Les documents de décision de la Commission, que j’ai consultés hier, dressent un portrait troublant. Ils décrivent Colegrove comme démontrant «une compréhension limitée de son comportement criminel» et notent son «association continue avec des pairs négatifs». Ces facteurs ont contribué significativement à la décision de la commission de refuser une libération discrétionnaire.
André Martineau, ancien agent correctionnel qui milite maintenant pour la réforme de la justice, m’a confié: «La règle des deux tiers existe pour éviter les ‘libérations froides’ où les délinquants passent directement de la sécurité maximale à la rue sans supervision. Mais dans les cas présentant des évaluations de risque élevé, cela crée une inquiétude publique compréhensible».
Ce qui rend cette affaire particulièrement remarquable, c’est la structure de libération conditionnelle qui sera imposée. Colegrove devra résider dans une maison de transition dans l’est de Montréal, respecter un couvre-feu strict et éviter tout contact avec des associés criminels connus. Ces conditions resteront en vigueur jusqu’à l’expiration officielle de sa peine fin 2025.
En me promenant dans le quartier où se trouve la maison de transition, j’ai remarqué le mélange de résidences et de petits commerces qui caractérisent tant de communautés montréalaises. Plusieurs résidents avec qui j’ai parlé ont exprimé un malaise face à la situation, bien que la plupart ignoraient les détails spécifiques.
«Je pense que tout le monde mérite une deuxième chance», a déclaré Jeannette Lapointe, qui habite le quartier depuis plus de 20 ans. «Mais le système devrait mieux préparer ces hommes avant qu’ils ne retournent dans nos rues».
Les statistiques de Sécurité publique Canada indiquent qu’environ 60% des délinquants fédéraux sont libérés en libération d’office plutôt qu’en libération conditionnelle. Les données montrent également que ceux qui se voient refuser la libération conditionnelle mais sont libérés automatiquement après avoir purgé les deux tiers de leur peine présentent des taux de récidive plus élevés que ceux qui obtiennent une libération conditionnelle plus tôt.
La Coalition pour la sécurité urbaine de Montréal a réagi en appelant à des réunions communautaires pour répondre aux préoccupations des résidents. «Nous croyons à la réintégration, mais aussi à la transparence», affirme Philippe Therrien, directeur de la coalition. «Les communautés méritent de comprendre comment ces décisions sont prises et quelles protections sont en place».
Pour sa part, Colegrove a maintenu un profil bas pendant son incarcération. Son avocat a refusé de commenter lorsque contacté, déclarant seulement que son client «a hâte de se conformer à toutes les conditions et de reconstruire sa vie».
L’affaire soulève des questions plus larges sur notre système correctionnel. Le Québec plaide depuis longtemps pour un plus grand contrôle provincial sur les services correctionnels fédéraux, faisant valoir que les programmes de réhabilitation communautaires montrent de meilleurs taux de réussite que le système actuel.
En réfléchissant à cette situation, je ne peux m’empêcher de penser à l’équilibre délicat entre punition et réhabilitation que notre société continue de naviguer. Ayant couvert de nombreuses histoires similaires au cours de mes années de reportage à Montréal, j’ai observé comment ces cas deviennent souvent des catalyseurs pour des débats plus larges sur la philosophie de la justice.
Lorsque Colegrove sortira de prison le mois prochain, il entrera dans une ville qui a considérablement changé pendant son incarcération. Le paysage post-pandémique de Montréal offre à la fois de nouvelles opportunités et de nouveaux défis pour ceux qui cherchent à se réintégrer.
Pour les résidents de Montréal, cette affaire rappelle la conversation permanente sur la façon dont notre système judiciaire gère la transition des délinquants vers la société – une conversation qui touche à la sécurité, à la réhabilitation et, finalement, au type de communauté que nous voulons bâtir ensemble.