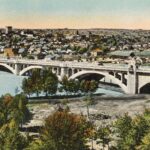Dans une initiative qui a provoqué des remous au sein des diverses communautés religieuses de Montréal, Mgr Christian Lépine s’est prononcé avec force contre le projet de loi québécois qui interdirait les rassemblements de prière publique. Cette mesure controversée, présentée hier par le gouvernement de la Coalition Avenir Québec, est rapidement devenue un point de friction dans le débat continu sur l’expression religieuse dans les espaces publics québécois.
« Ce projet d’interdiction s’attaque au cœur de nos libertés fondamentales, » a déclaré Mgr Lépine lors d’une conférence de presse tenue à la Cathédrale Marie-Reine-du-Monde. « La prière n’est pas simplement un acte religieux, mais l’expression de notre humanité profonde, qui mérite protection dans une société véritablement démocratique. »
Le projet de loi 59 interdirait les rassemblements de prière organisés dans les parcs publics, les rues et autres espaces appartenant au gouvernement. Les responsables gouvernementaux ont présenté cette mesure comme une extension de l’engagement de la province envers la laïcité, suivant la controversée Loi 21 adoptée en 2019 qui interdisait les signes religieux pour les fonctionnaires en position d’autorité.
Le premier ministre François Legault a défendu la proposition en déclarant: « Les espaces publics appartiennent à tous les Québécois, quelle que soit leur foi. Nous nous assurons que ces lieux restent neutres et accueillants pour tous. » Le premier ministre a souligné que l’interdiction s’appliquerait également à tous les groupes religieux et ne ciblerait aucune tradition religieuse spécifique.
Cependant, les leaders religieux à travers Montréal perçoivent différemment cette mesure. La rabbine Sarah Goldstein de la Congrégation Shaar Hashomayim a qualifié la proposition de « profondément troublante » et a averti qu’elle pourrait repousser l’expression religieuse davantage vers les marges de la société. « Le droit de se rassembler pour prier n’a jamais menacé le caractère laïque du Québec, » a-t-elle noté.
Le moment choisi pour cette annonce a suscité des interrogations, survenant quelques semaines avant plusieurs observances religieuses importantes de différentes confessions. L’imam Syed Hassan du Centre islamique de Montréal a exprimé son inquiétude quant à l’impact de cette interdiction sur les rassemblements traditionnels. « Depuis des générations, de nombreux musulmans se réunissent pour des prières spéciales dans les parcs pendant les célébrations de l’Aïd lorsque nos mosquées débordent. Ce sont des traditions pacifiques et significatives qui ne nuisent à personne. »
Les groupes de défense des libertés civiles ont déjà annoncé leur intention de contester cette législation. La représentante québécoise de l’Association canadienne des libertés civiles, Marie-Claude Landry, a déclaré à LCN que l’organisation considère cette interdiction comme « constitutionnellement discutable et un abus d’autorité gouvernementale sur des expressions protégées de la foi. »
Cette proposition revêt une importance particulière à Montréal, longtemps considérée comme la ville la plus religieusement diverse du Québec. Chaque fin de semaine, le parc du Mont-Royal accueille des cercles de prière informels, des groupes de méditation et des rassemblements religieux représentant le tissu multiculturel de la ville.
Je couvre les questions de liberté religieuse à Montréal depuis près d’une décennie, et j’ai rarement vu une opposition aussi immédiate et unifiée de la part des leaders religieux. L’été dernier, j’ai assisté à une veillée de prière interconfessionnelle à la Place des Arts suite à l’incendie de la Basilique Notre-Dame – exactement le type de rassemblement que cette législation interdirait.
La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a adopté une position prudente, déclarant que bien que la ville respecte la juridiction provinciale, « l’identité de Montréal est construite sur la diversité et l’inclusion, et nous devons nous assurer que tous les citoyens se sentent bienvenus dans nos espaces publics. »
Le professeur Daniel Weinstock, qui enseigne le droit et les études religieuses à l’Université McGill, suggère que la législation reflète les tensions persistantes dans la société québécoise. « Il y a une incompréhension fondamentale de ce qu’exige la laïcité, » a-t-il expliqué. « La vraie laïcité signifie la neutralité de l’État envers la religion, non pas l’effacement de la religion de la vie publique. »
Les données de Statistique Canada montrent qu’environ 68% des Québécois s’identifient comme catholiques, bien que la pratique régulière ait considérablement diminué ces dernières décennies. Parallèlement, la province a connu une croissance d’autres communautés religieuses, particulièrement à Montréal où près de 8% des résidents s’identifient comme musulmans et 2% comme juifs.
Le débat touche à des questions profondément personnelles pour de nombreux Montréalais. Marie Tremblay, une enseignante retraitée avec qui j’ai parlé devant la Basilique Notre-Dame, a exprimé des sentiments mitigés. « Je crois en l’orientation laïque du Québec, mais la prière en elle-même ne fait de mal à personne. Il doit y avoir de la place à la fois pour la laïcité et le respect de la foi personnelle. »
Alors que l’automne approche, l’Assemblée nationale devrait commencer le débat formel sur le projet de loi lorsque les sessions reprendront la semaine prochaine. Les communautés religieuses et les organisations de défense des libertés civiles organisent déjà des réponses publiques, y compris une manifestation interconfessionnelle prévue à l’Assemblée législative provinciale.
Quel que soit le résultat, cette proposition marque un nouveau chapitre dans la relation complexe du Québec avec l’expression religieuse dans la vie publique – une relation qui continue de façonner le paysage culturel de Montréal et au-delà.