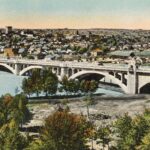En me promenant dans les couloirs colorés de l’École Secondaire Saint-Henri, l’énergie habituellement vibrante semble quelque peu diminuée. Les enseignants se précipitent entre les cours avec des piles supplémentaires de documents sous le bras, et la salle d’art—normalement un kaléidoscope de créativité étudiante—reste verrouillée un mardi après-midi.
« C’est difficile cette année, » soupire Marianne Tremblay, qui enseigne la littérature française ici depuis quinze ans. « On fait plus avec moins, comme toujours, mais cette fois-ci, c’est différent. »
La différence à laquelle Tremblay fait référence découle des controversés ajustements budgétaires en éducation annoncés par le Québec au printemps dernier. La décision du gouvernement provincial de réduire le financement de l’éducation d’environ 247 millions de dollars a envoyé des ondes de choc à travers le paysage éducatif diversifié de Montréal, affectant tout, des programmes artistiques aux services de soutien essentiels.
La Coalition Avenir Québec a défendu ces mesures comme une restriction fiscale nécessaire face aux pressions économiques. Le ministre de l’Éducation Bernard Drainville a déclaré que les écoles doivent « trouver des efficiences sans compromettre la qualité éducative, » une affirmation qui a provoqué un scepticisme considérable parmi les éducateurs.
À Saint-Henri, ces « efficiences » se traduisent par trois assistants d’enseignement en moins, un programme de musique réduit, et des classes plus nombreuses—passant d’une moyenne de 26 élèves par classe à près de 32 dans certains cas.
« Les maths ne fonctionnent tout simplement pas, » explique Robert Gendron, directeur du Centre de services scolaire de Montréal. « Quand on réduit les ressources humaines alors que les besoins des élèves augmentent, quelque chose doit céder. »
Ce qui cède, selon les parents et les enseignants à travers Montréal, ce sont les programmes supplémentaires et l’attention individualisée qui rendaient le système d’éducation québécois distinctif. Les programmes artistiques, les activités parascolaires et le soutien spécialisé pour les élèves ayant des difficultés d’apprentissage ont tous connu des réductions.
L’Association des enseignants de Montréal rapporte qu’environ 420 postes d’enseignement à travers l’île resteront non pourvus ou seront éliminés en raison des contraintes budgétaires. Cela représente environ 4% de l’effectif enseignant total dans les écoles montréalaises.
Pour les familles des quartiers comme Côte-des-Neiges et Parc-Extension, où de nombreux élèves nouveaux arrivants nécessitent un soutien linguistique supplémentaire, ces coupes semblent particulièrement sévères.
« Ma fille recevait auparavant du tutorat en français deux fois par semaine, » dit Maria Constanza, dont la famille a déménagé du Pérou il y a trois ans. « Maintenant c’est une fois par semaine dans un groupe de huit élèves au lieu de quatre. Je m’inquiète qu’elle prenne du retard. »
Les réductions budgétaires arrivent à un moment difficile. Les écoles québécoises se remettaient encore des perturbations d’apprentissage liées à la pandémie lorsque les contraintes financières se sont resserrées. Une étude récente de l’Université de Montréal indiquait qu’environ 28% des élèves montréalais présentaient d’importantes lacunes d’apprentissage dans les matières principales suite aux interruptions dues à la COVID-19—des lacunes qui se sont réduites mais n’ont pas disparu pendant la période de récupération.
À l’école secondaire Westmount, le directeur James Williams a eu recours à des solutions créatives. « Nous avons établi des partenariats avec des étudiants en éducation de McGill qui font du bénévolat deux fois par semaine. Des entreprises locales ont parrainé notre programme STIM. Nous survivons grâce à la bonne volonté de la communauté, » me confie-t-il lors d’une brève conversation entre ses nombreuses responsabilités quotidiennes.
Les comités de parents des commissions scolaires de Montréal se sont mobilisés en réponse. La Fédération des comités de parents du Québec a organisé trois manifestations depuis mai, la plus importante ayant rassemblé environ 12 000 participants à la Place des Arts le mois dernier.
« Ce ne sont pas simplement des chiffres sur une feuille de calcul, » insiste Catherine Harel, présidente de l’Alliance des parents de Montréal. « Chaque dollar retiré représente une opportunité perdue pour nos enfants. Nous parlons de leur avenir. »
L’impact financier varie considérablement selon le quartier et la commission scolaire. Les écoles des quartiers plus aisés ont des fondations de parents qui peuvent partiellement compenser les coupes gouvernementales par des collectes de fonds. À Westmount et Outremont, les associations de parents ont recueilli entre 60 000 $ et 120 000 $ l’année dernière pour préserver les programmes d’enrichissement.
Cette disparité trouble de nombreux défenseurs de l’éducation. « Nous créons un système à deux vitesses, » avertit le professeur Claude Lessard, expert en politique éducative à l’Université de Montréal. « Les écoles des quartiers aisés peuvent amortir ces coupes grâce à des collectes de fonds privées. Celles des quartiers populaires ne le peuvent pas. »
Peut-être plus préoccupantes encore sont les coupes dans les services psychologiques et les soutiens à l’éducation spécialisée. Les écoles publiques de Montréal ont connu une réduction de 15% des heures allouées aux psychologues, orthophonistes et conseillers en éducation spécialisée.
« Nous identifions les élèves qui ont besoin d’aide, mais nous sommes maintenant confrontés à des listes d’attente de plusieurs mois pour fournir cette aide, » explique Sophie Bergeron, psychologue scolaire desservant trois écoles primaires de l’est de la ville. « Il y a cinq ans, je travaillais avec deux écoles. Les besoins n’ont pas diminué—seules les ressources ont diminué. »
Pour certaines familles, la solution a été le système d’éducation privée du Québec, qui éduque déjà près de 17% des élèves de la province—la proportion la plus élevée au Canada. Les demandes d’inscription aux établissements privés ont augmenté de 12% cette année, selon la Fédération des établissements d’enseignement privés.
De retour à Saint-Henri, je suis témoin de quelque chose à la fois déchirant et inspirant. Dans la salle des professeurs, les éducateurs mettent en commun des fonds personnels pour acheter des fournitures scolaires. Tremblay contribue 50 $ pour un ensemble de romans pour la classe. Un autre enseignant offre de partager son imprimante puisque celle du département a été retirée pour économiser les coûts d’entretien.
« On continue, » dit Tremblay avec une résignation déterminée qui semble capturer l’esprit des éducateurs québécois. « Ces élèves n’ont pas créé cette situation, et ils ne devraient pas en subir les conséquences. Alors on s’adapte. »
Alors que l’année scolaire montréalaise progresse sous ces contraintes, l’impact complet reste à voir. Ce qui est déjà évident, c’est que le système éducatif québécois, longtemps source de fierté provinciale, se trouve à la croisée des chemins où les décisions financières d’aujourd’hui façonneront les résultats éducatifs pour les années à venir.