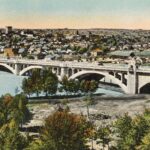En tant que résident de Montréal depuis près de vingt ans, l’annonce de l’évasion d’une meurtrière condamnée d’une prison de notre province fait frémir notre communauté. Hier après-midi, les autorités ont confirmé que Lori Germa, une femme de 69 ans purgeant une peine à perpétuité pour meurtre au second degré, s’est évadée de la Maison Tanguay, un établissement à sécurité minimale à Laval, juste au nord de Montréal.
Le Service correctionnel du Canada a émis une alerte peu après avoir découvert l’absence de Germa lors du dénombrement de 15h30. Selon la porte-parole du SCC, Julie Tremblay, « Toutes les mesures sont prises pour que cette personne soit appréhendée le plus rapidement possible. » La Sûreté du Québec et les forces policières locales se sont mobilisées dans ce qu’elles appellent un « effort de recherche coordonné. »
Germa a été condamnée en 2006 pour le meurtre de son mari, reconnue coupable de l’avoir empoisonné avec de l’antigel ajouté à sa nourriture pendant plusieurs mois. L’affaire avait choqué notre communauté à l’époque, particulièrement parce que Germa a maintenu son innocence tout au long du procès malgré des preuves médico-légales accablantes.
Ayant couvert de nombreux reportages sur notre système correctionnel au fil des ans, j’ai observé une tendance inquiétante d’évasions des établissements à sécurité minimale au Québec. L’année dernière seulement, trois détenus se sont évadés de différentes institutions à travers la province, soulevant de sérieuses questions sur les protocoles de sécurité.
« C’est préoccupant tant pour la sécurité publique que pour la confiance envers notre système correctionnel, » note la criminologue Sophie Bélanger de l’Université de Montréal, avec qui j’ai parlé ce matin. « Les désignations à sécurité minimale sont censées être accordées uniquement à ceux qui présentent un risque minimal de fuite. »
La police décrit Germa comme mesurant 1m63, avec des cheveux gris et des yeux bruns, aperçue pour la dernière fois portant ce qui semble être une veste et un pantalon foncés. Elle a des liens familiaux dans la Montérégie et les Cantons de l’Est, des régions où les autorités concentrent une attention particulière.
Cette évasion soulève d’importantes questions sur l’âge et les évaluations de sécurité dans notre système carcéral. À 69 ans, Germa représente un défi démographique de plus en plus courant pour les services correctionnels – la gestion de détenus vieillissants qui peuvent sembler présenter des risques de sécurité réduits en raison de leur âge.
« L’âge ne devrait pas automatiquement qualifier quelqu’un pour une sécurité réduite, » explique Jean Tremblay, agent correctionnel à la retraite qui a travaillé dans des institutions québécoises pendant 27 ans. « La nature du crime et les évaluations psychologiques continues doivent rester des facteurs primaires. »
Pour les résidents de Laval et des environs, l’évasion a suscité une vigilance accrue. Les écoles locales ont été avisées, bien qu’aucune mesure de confinement n’ait été mise en place. La police de Montréal a augmenté les patrouilles dans certains quartiers, particulièrement ceux ayant des liens avec le passé de Germa.
En tant que personne qui a élevé une famille dans cette ville, je comprends l’inquiétude de nombreux parents. À l’école de ma fille ce matin, l’évasion était le sujet principal parmi les parents qui attendaient à la dépose. « Ce n’est pas quelque chose à quoi on s’attend à s’inquiéter en 2023, » m’a confié une mère, « une criminelle de l’âge d’une grand-mère en liberté. »
Le moment de l’évasion – quelques semaines seulement avant l’audience de libération conditionnelle prévue de Germa – ajoute une autre dimension à cette histoire en développement. Des sources proches de l’enquête suggèrent qu’elle aurait pu craindre un résultat négatif après une récente évaluation psychologique.
La coopération citoyenne reste essentielle dans ces situations. La Sûreté du Québec a établi une ligne téléphonique dédiée au 1-800-659-4264, soulignant qu’il ne faut pas approcher Germa si on l’aperçoit.
Alors que notre communauté traite cette nouvelle, nous nous rappelons que sous la façade culturelle vibrante de Montréal existent les mêmes préoccupations pour la sûreté et la sécurité que partout ailleurs. L’enquête se poursuit, et nous à LCN.aujourd’hui fournirons des mises à jour à mesure que cette situation évolue.