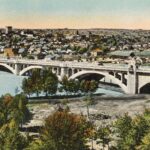Sous le soleil couchant du territoire de Kahnawake le week-end dernier, les battements rythmiques des tambours traditionnels résonnaient à travers le terrain du pow-wow, marquant un jalon émouvant : 35 ans depuis la Crise d’Oka qui a changé à jamais les relations entre Autochtones et non-Autochtones au Québec.
Le pow-wow annuel «Échos d’une Nation Fière» a revêtu une importance particulière cette année, attirant des milliers de visiteurs de Montréal et d’ailleurs pour commémorer ce que beaucoup ici considèrent comme un tournant dans l’histoire moderne mohawk.
«Ce n’est pas seulement une célébration – c’est une mémoire vivante», explique l’Aîné Joseph McComber, qui a participé à la confrontation de 1990. «Pendant 78 jours, nous avons tenu bon. Aujourd’hui, nous nous rassemblons non pas dans la colère mais dans la force, montrant comment notre culture continue de s’épanouir.»
La Crise d’Oka de 1990 a commencé lorsque la ville d’Oka a prévu d’agrandir un terrain de golf sur un territoire contesté qui comprenait un cimetière mohawk. La confrontation qui s’en est suivie s’est transformée en impasse armée impliquant la Sûreté du Québec, les Forces armées canadiennes et les Guerriers mohawks de Kahnawake et Kanesatake.
En parcourant le site, je suis frappé par la démonstration vibrante de résilience. Des tenues cérémonielles colorées captent la lumière de l’après-midi tandis que des danseurs de tous âges participent aux compétitions traditionnelles. Des vendeurs bordent le périmètre, offrant tout, des bijoux artisanaux aux médecines traditionnelles.
«Le premier pow-wow après la crise était un acte de guérison», affirme Alana Goodleaf-Rice, l’une des organisatrices de l’événement. «Trente-cinq ans plus tard, il continue de rassembler les gens. La crise a été douloureuse, mais elle a éveillé de nombreux Canadiens aux réalités autochtones qui avaient été ignorées trop longtemps.»
En effet, plusieurs participants avec qui j’ai discuté croient que la Crise d’Oka a marqué un moment décisif dans la conscience canadienne. Avant que les médias sociaux ne puissent diffuser instantanément les injustices mondiales, les images de la confrontation faisaient la une des journaux internationaux.
Marie Tremblay, résidente de Montréal, a amené ses enfants pour vivre cette célébration culturelle. «J’étais trop jeune pour comprendre quand c’est arrivé, mais maintenant je veux que mes enfants apprennent cette histoire directement», me dit-elle en regardant une compétition de danse jeunesse. «Ces histoires ne sont pas enseignées correctement dans nos écoles.»
Ce qui ressort de ce rassemblement anniversaire, c’est le dialogue intergénérationnel qui se déroule à chaque instant. Les Aînés qui ont vécu la crise partagent leurs récits avec des adolescents qui n’étaient pas encore nés en 1990.
Karahkwenhawi Cross, 16 ans, représente cette nouvelle génération. «Mes grands-parents étaient ici pendant les barricades», dit-elle en ajustant sa robe à clochettes avant une performance. «Ils m’ont appris que le pow-wow n’est pas seulement de la danse – c’est de la résistance. C’est dire : nous sommes toujours là, notre culture survit.»
Selon les données de l’Association des femmes autochtones du Québec, l’intérêt pour les événements culturels autochtones n’a cessé de croître depuis les années 1990, la participation aux grands pow-wows ayant augmenté de près de 40 % au cours de la dernière décennie.
L’impact économique est également significatif. Une étude récente de Tourisme Montréal estime que le tourisme culturel centré sur les événements autochtones rapporte environ 8,5 millions de dollars annuellement à la grande région montréalaise.
Au-delà des statistiques, il y a quelque chose de profondément émouvant à voir les survivants de la crise rire avec leurs petits-enfants tout en dégustant des plats traditionnels ou en choisissant des articles faits à la main.
«Après la chute des barricades, nous avions besoin de guérison», réfléchit l’ancien Chef de Kahnawake Joe Norton, qui a dirigé la communauté pendant ces mois tumultueux. «Le pow-wow est devenu notre médecine. Aujourd’hui, c’est à la fois commémoration et célébration.»
Toutes les blessures n’ont cependant pas guéri. De nombreux membres de la communauté expriment leur frustration face aux litiges fonciers en cours et à ce qu’ils considèrent comme des promesses non tenues de divers paliers de gouvernement.
«La crise a attiré l’attention, mais la vraie réconciliation nécessite des actions», déclare la professeure Audra Simpson du programme d’études autochtones de l’Université McGill. «Des événements comme ce pow-wow créent un espace pour la fierté culturelle, mais les changements structurels avancent beaucoup plus lentement.»
À la tombée de la nuit, la grande entrée commence. Des danseurs de tous âges entrent dans le cercle derrière les porteurs de bâtons à aigle et les vétérans. L’annonceur demande aux spectateurs de se lever par respect, et la foule devient silencieuse.
Dans ce moment, le double objectif du rassemblement devient clair – célébration entrelacée avec le souvenir. Pour la communauté mohawk, le pow-wow représente la continuité culturelle malgré les tentatives historiques d’effacement.
«Nous invitons tout le monde à partager nos traditions aujourd’hui», dit Goodleaf-Rice. «Mais nous leur demandons aussi de se souvenir pourquoi ce pow-wow existe – parce que des gens étaient prêts à défendre ce qui était sacré.»
Alors que je me prépare à partir, une averse d’été commence, mais personne ne semble découragé. Les tambours continuent, les danseurs ajustent leurs tenues, et les conversations se poursuivent sous des auvents hâtivement érigés.
La pluie semble symbolique – purifiante mais temporaire, tout comme l’attention médiatique qui s’est brièvement concentrée sur les questions autochtones pendant la crise avant de se déplacer ailleurs.
Mais ici à Kahnawake, la mémoire reste vibrante, transmise à travers des histoires, des chansons et des rassemblements comme celui-ci – garantissant que ce qui s’est passé pendant ces 78 jours ne sera jamais oublié.