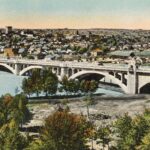Alors que le soleil se couchait sur l’horizon de Montréal hier soir, une affaire juridique remarquable s’est conclue au palais de justice fédéral du centre-ville. Dans une décision qui a déjà suscité d’intenses débats à travers notre ville, une Montréalaise qui a avoué avoir rejoint l’État islamique d’Irak et du Levant (EIIL) a reçu ce que beaucoup considèrent comme une sentence étonnamment clémente – seulement un jour de prison, suivi de trois ans de probation.
La femme de 29 ans, dont l’identité reste protégée par une interdiction de publication, a plaidé coupable d’avoir quitté le Canada pour participer aux activités d’un groupe terroriste. Son retour au Canada et sa poursuite ultérieure représentent un cas rare parmi la douzaine de Québécois estimés qui ont voyagé en Syrie pour rejoindre des groupes extrémistes pendant l’apogée du contrôle territorial de l’EIIL.
« Cette sentence reflète les circonstances uniques de cette affaire, » a expliqué Me Martine Dubois, avocate spécialisée en droit criminel et sécurité nationale, qui n’était pas directement impliquée. « La cour a probablement considéré plusieurs facteurs atténuants, notamment sa coopération avec les autorités et son potentiel de réhabilitation. »
Les documents judiciaires révèlent que la femme a quitté Montréal en 2014, voyageant via la Turquie avant d’entrer dans le territoire contrôlé par l’EIIL en Syrie. Elle y est restée environ trois ans avant de s’échapper de ce que son avocat a décrit comme « des circonstances de plus en plus désespérées. » À son retour au Canada en 2019, elle a été arrêtée par l’Équipe intégrée de la sécurité nationale de la GRC.
La brièveté de la peine a soulevé des sourcils dans les diverses communautés montréalaises. Au Café Olympico dans le Mile End ce matin, où je me suis arrêté pour mon espresso habituel, des conversations animées sur l’affaire emplissaient l’air.
« Comment peut-on rejoindre une organisation terroriste et essentiellement repartir libre? » s’est interrogé Jean-Philippe Tremblay, un professeur d’université que j’ai interviewé précédemment sur des questions de justice. « Cela envoie un message troublant sur notre perception du terrorisme. »
D’autres, cependant, ont exprimé des perspectives plus nuancées. Fatima Benali, directrice du Centre montréalais d’intégration culturelle, a suggéré que l’affaire met en lumière la complexité de la radicalisation. « Les jeunes qui rejoignent des groupes extrémistes le font souvent à partir d’une position de vulnérabilité, pas de malveillance inhérente, » m’a-t-elle dit lors de notre conversation téléphonique ce matin. « La réhabilitation, pas seulement la punition, doit être notre objectif. »
Le procureur de la Couronne avait initialement demandé une peine de cinq ans d’emprisonnement, arguant que rejoindre l’EIIL représentait l’une des infractions terroristes les plus graves possibles. Cependant, la juge a cité plusieurs facteurs dans sa décision, notamment la pleine coopération de l’accusée avec les autorités, sa dénonciation de l’idéologie de l’EIIL, et des preuves suggérant qu’elle avait été manipulée et contrainte pendant son séjour en Syrie.
Cette affaire émerge dans le contexte de la lutte continue du Canada pour gérer les citoyens qui ont voyagé à l’étranger pour rejoindre des groupes terroristes. Selon le Service canadien du renseignement de sécurité, environ 250 Canadiens se sont rendus en Syrie et en Irak depuis 2012, dont environ 60 sont revenus. Le Québec a connu un nombre disproportionné de ces cas, particulièrement parmi les jeunes adultes de notre région.
« Le défi pour notre système judiciaire est d’équilibrer la sécurité publique avec la réhabilitation, » a expliqué François Bernier, ancien conseiller à Sécurité publique Canada, lorsque je l’ai joint par téléphone. « Ces cas existent dans une zone grise entre justice pénale et sécurité nationale. »
La sentence inclut des conditions strictes au-delà du jour unique d’incarcération. La femme doit régulièrement se présenter aux autorités, participer à des programmes de déradicalisation, rendre son passeport et observer un couvre-feu. Il lui est également interdit d’utiliser les plateformes de médias sociaux sans supervision.
En marchant à travers la Place d’Armes cet après-midi, je ne pouvais m’empêcher de réfléchir à la façon dont cette affaire nous force à confronter des questions difficiles sur la justice, la rédemption et la sécurité communautaire. L’imposant palais de justice se dresse comme un rappel que même nos problèmes sociétaux les plus difficiles doivent ultimement être traités par nos institutions juridiques, aussi imparfaites soient-elles.
L’Association musulmane de Montréal a publié aujourd’hui une déclaration soulignant que les idéologies extrémistes représentent une distorsion des enseignements islamiques. « Notre communauté s’oppose fermement à toutes formes de violence et d’extrémisme, » indique le communiqué. « Nous soutenons les efforts pour réhabiliter ceux qui ont été induits en erreur tout en assurant la responsabilité pour les actions préjudiciables. »
Le bureau du ministre de la Sécurité publique a décliné ma demande de commentaire spécifique sur cette affaire, mais a fourni une déclaration réaffirmant l’engagement du gouvernement à combattre le terrorisme par « des voies légales appropriées tout en respectant l’indépendance de la magistrature. »
Alors que Montréal continue de digérer cette affaire inhabituelle, elle nous rappelle comment les conflits mondiaux peuvent atteindre le cœur de nos communautés locales. L’équilibre délicat entre justice, réhabilitation et sécurité publique reste une conversation continue – qui définit non seulement notre système juridique, mais aussi qui nous sommes en tant que société.