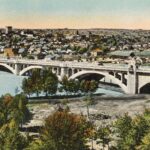Le conflit qui se prépare entre l’Alberta et Ottawa concernant la législation sur l’eau potable des Premières Nations en dit long sur l’interaction complexe entre les droits provinciaux, la souveraineté autochtone et l’autorité fédérale qui continue de façonner notre paysage national.
Je suis cette situation depuis février, quand la première ministre Smith a d’abord signalé l’opposition de l’Alberta au projet de loi fédéral C-61. Ce qui a commencé comme un désaccord politique a évolué vers quelque chose de plus significatif, avec l’Ontario qui rejoint maintenant la résistance de l’Alberta à la législation proposée sur l’eau potable pour les Premières Nations.
En cause, la Loi sur l’eau potable pour les Premières Nations d’Ottawa, qui vise à élaborer des règlements concernant l’eau et les eaux usées sur les territoires des Premières Nations. Le gouvernement fédéral présente cela comme une réponse à un besoin critique, soulignant des décennies d’avis et de défaillances d’infrastructures qui ont laissé de nombreuses communautés autochtones sans eau potable.
« Il ne s’agit pas simplement de compétence, mais de responsabilité, » m’a confié une source au sein du ministère des Relations autochtones de l’Alberta lors d’un briefing en coulisse la semaine dernière. « La province estime que les communautés des Premières Nations méritent mieux que ce qu’Ottawa leur a offert. »
Le gouvernement de la première ministre Smith soutient que la gestion de l’eau relève clairement de la compétence provinciale selon la Constitution. Ses récentes déclarations soulignent que l’Alberta possède déjà des systèmes « robustes » de gestion de l’eau qui pourraient mieux servir les communautés des Premières Nations grâce à des partenariats directs plutôt que par une supervision fédérale.
Les chiffres dressent un tableau préoccupant de la situation actuelle. Selon Services aux Autochtones Canada, il existe encore 29 avis à long terme concernant l’eau potable en vigueur dans les communautés des Premières Nations à l’échelle nationale. Bien que cela représente un progrès significatif par rapport aux 105 avis de 2015, la persistance de ces problèmes souligne l’urgence de trouver des solutions efficaces.
Le chef Billy Morin de la Nation crie d’Enoch a offert une perspective nuancée lorsque je lui ai parlé lors d’une récente conférence sur le développement économique à Calgary. « Les Premières Nations doivent être au centre de ces discussions, » a-t-il déclaré. « Provincial ou fédéral — ce qui compte le plus, c’est que les solutions soient élaborées avec notre pleine participation et notre consentement. »
L’entrée de l’Ontario dans cette bataille juridictionnelle ajoute une couche supplémentaire de complexité. Le gouvernement du premier ministre Doug Ford a envoyé une lettre à la ministre fédérale des Services aux Autochtones, Patty Hajdu, exprimant des préoccupations constitutionnelles similaires concernant l’empiétement fédéral sur l’autorité provinciale en matière de gestion de l’eau.
Le ministre des Relations autochtones de l’Alberta, Rick Wilson, maintient qu’une supervision provinciale serait plus réactive aux besoins locaux. « Nous comprenons les défis uniques des bassins versants de l’Alberta et avons des décennies d’expérience dans la gestion efficace des ressources en eau, » a déclaré Wilson lors d’une conférence de presse à laquelle j’ai assisté à Edmonton le mois dernier.
Le gouvernement fédéral réplique que son approche respecte à la fois les droits issus des traités et le besoin pressant de normes nationales. La ministre Hajdu a souligné que le projet de loi C-61 a été élaboré « en partenariat avec les Premières Nations » et a accusé les provinces de placer « les arguments de compétence au-dessus du droit humain fondamental à l’eau potable. »
L’experte en politique de l’eau, Dr. Sarah Thompson de l’Université de Calgary, souligne le contexte historique plus profond. « Ce différend reflète des tensions de longue date dans le fédéralisme canadien, » a-t-elle expliqué lors de notre entretien. « Mais il révèle aussi comment les communautés autochtones se retrouvent souvent prises entre différents niveaux de gouvernement qui revendiquent leur autorité sur leurs vies. »
Pour de nombreux leaders des Premières Nations, la querelle de compétence passe complètement à côté de l’essentiel. La chef nationale Cindy Woodhouse Nepinak de l’Assemblée des Premières Nations a souligné que « l’eau potable n’est pas un débat constitutionnel — c’est un droit humain fondamental qui a été refusé à trop de Premières Nations pendant trop longtemps. »
La législation propose de transférer l’autorité des règlements sur l’eau potable à Services aux Autochtones Canada, travaillant avec les Premières Nations pour établir des normes de qualité de l’eau, de traitement et de systèmes de distribution. Mais les critiques remettent en question si le gouvernement fédéral a démontré l’engagement nécessaire pour rendre une telle approche efficace.
La ministre de l’Environnement de l’Alberta, Rebecca Schulz, souligne la stratégie Water for Life de la province comme preuve de la capacité de l’Alberta à aborder efficacement la gestion de l’eau. « Nous avons démontré notre engagement envers une gestion durable de l’eau depuis deux décennies, » a-t-elle noté lors des discussions sur le budget provincial.
Ce qui est souvent négligé dans ce débat, c’est l’expérience vécue par les personnes les plus touchées. Lors de ma visite à la Nation Siksika le mois dernier, les membres de la communauté ont décrit les défis pratiques de vivre sous des avis d’ébullition d’eau — du fardeau financier de l’achat d’eau embouteillée aux impacts sur la santé des aînés et des enfants.
Alors que cette histoire continue de se développer, une chose reste claire : résoudre la crise de l’eau des Premières Nations au Canada nécessitera de dépasser les guerres de territoire juridictionnelles pour adopter des approches collaboratives qui placent les voix et les besoins autochtones au centre. Les semaines à venir révéleront si une telle collaboration est possible dans notre climat politique actuel.
Pour les résidents de Calgary qui observent ce déroulement, le différend offre une fenêtre sur des questions plus larges concernant la gouvernance de nos ressources naturelles et l’accomplissement de nos responsabilités collectives envers les communautés autochtones. Ces questions ne feront que devenir plus pressantes à mesure que le changement climatique et la croissance démographique exerceront une pression supplémentaire sur nos systèmes d’eau dans les années à venir.