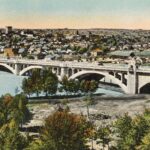Le premier cas médiatisé d’une femme montréalaise collaboratrice de l’État islamique s’est conclu hier lorsque Oumaima Chouay, 29 ans, a reçu une peine de neuf ans d’emprisonnement après avoir plaidé coupable à des accusations de participation à des activités terroristes. Ce jugement a créé des remous dans notre communauté juridique et soulève d’importantes questions sur la radicalisation au Québec.
J’étais présent dans la salle d’audience lorsque Chouay, mère de deux jeunes enfants, se tenait debout en silence pendant que la juge Sophie Bourque prononçait la sentence au palais de justice de Montréal. La gravité du moment n’a échappé à personne – cette affaire marque l’une des poursuites antiterroristes les plus significatives impliquant une femme au Canada.
« L’accusée s’est sciemment rendue en Syrie en 2014 et a fourni un soutien à l’EI pendant environ cinq ans, » a déclaré la juge Bourque, soulignant que Chouay avait épousé un combattant de l’EI et participé à la promotion de l’idéologie de l’organisation.
Ce qui m’a le plus frappé, c’était le contraste entre la gravité des accusations et le comportement de Chouay. Après avoir couvert de nombreuses affaires judiciaires à Montréal, j’ai rarement été témoin d’une intersection aussi complexe entre idéologie, choix personnels et conséquences.
La procureure fédérale Lyne Décarie a déclaré aux journalistes par la suite que cette sentence « envoie un message clair que le Canada traite les infractions terroristes avec la plus grande sérieux, indépendamment du genre. » Le ministère public avait initialement demandé une peine de 12 ans, tandis que les avocats de la défense plaidaient pour sept ans, citant la coopération de Chouay et ses expressions de remords.
Selon les documents judiciaires, Chouay a quitté Montréal en 2014, passant par la Turquie pour rejoindre le territoire contrôlé par l’EI en Syrie. Elle a été détenue en 2019 dans un camp géré par les Kurdes avant d’être rapatriée au Canada en 2022 avec ses enfants.
Le commissaire de la GRC Mike Duheme a souligné que cette affaire démontre l’engagement du Canada à poursuivre tous les individus impliqués dans des activités terroristes à l’étranger. « Cette condamnation souligne notre vigilance constante contre les menaces à la sécurité nationale, » a-t-il déclaré lors d’une brève conférence de presse devant le palais de justice.
Me Charles Montpetit, avocat de la défense, a décrit le parcours de sa cliente vers la radicalisation comme « une série de choix tragiques influencés par la propagande en ligne et des vulnérabilités personnelles. » Il a soutenu que Chouay a depuis rejeté l’idéologie extrémiste et souhaite reconstruire sa vie.
L’affaire résonne particulièrement à Montréal, où plusieurs cas de radicalisation d’envergure ont émergé au cours de la dernière décennie. Le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence rapporte qu’entre 2013 et 2018, environ 30 personnes du Québec ont quitté ou tenté de quitter le Canada pour rejoindre des groupes extrémistes à l’étranger.
Les leaders communautaires à qui j’ai parlé ont exprimé des réactions mitigées. L’imam Hassan Guillet du Conseil des imams du Québec a souligné l’importance de l’éducation et de la vigilance communautaire. « Cette affaire nous rappelle que la radicalisation peut toucher n’importe qui, et nous devons rester engagés à promouvoir des valeurs inclusives et la pensée critique, » m’a-t-il confié.
La sociologue Marie-Ève Carignan de l’Université de Sherbrooke, qui étudie les modèles de radicalisation, souligne que l’implication des femmes dans les groupes extrémistes est souvent mal comprise. « Il y a une tendance à voir les femmes uniquement comme des victimes plutôt que de reconnaître leur libre arbitre dans ces décisions, ce qui complique les efforts de prévention et d’intervention, » m’a-t-elle expliqué lors de notre conversation téléphonique.
La situation des enfants ajoute une autre couche de complexité. Les services de protection de la jeunesse du Québec ont confirmé qu’ils travaillent pour s’assurer que les enfants reçoivent un soutien approprié tout en maintenant les liens familiaux lorsque possible. Le psychologue pour enfants Dr Robert Leclerc a noté que « les enfants revenant des zones de conflit font face à des défis uniques nécessitant des soins spécialisés tenant compte des traumatismes. »
En quittant le palais de justice hier, je ne pouvais m’empêcher de réfléchir à la façon dont cette affaire révèle la réalité complexe des poursuites antiterroristes. Il est facile de voir ces cas en noir et blanc, mais mes années à couvrir les diverses communautés de Montréal m’ont appris que les histoires humaines s’intègrent rarement dans des récits simples.
Alors que notre ville traite cette affaire historique, l’enseignement le plus important est peut-être la nécessité d’approches équilibrées tant pour la sécurité que pour la prévention. Montréal s’est longtemps enorgueillie d’être un carrefour multiculturel où diverses communautés prospèrent ensemble. Cette affaire nous met au défi de maintenir cette vision inclusive tout en répondant à de sérieuses préoccupations de sécurité.
La peine de neuf ans signifie que Chouay restera probablement incarcérée jusqu’en 2030 au moins, en tenant compte du temps déjà purgé. Son avocat a indiqué qu’elle ne prévoit pas faire appel de la décision.