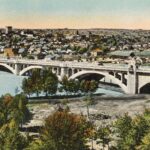La semaine dernière a été marquée par un deuil profond et des interrogations sérieuses pour les Montréalais suite à la fusillade policière qui a coûté la vie à Nooran Rezayi, 17 ans. Alors que notre ville est aux prises avec cette tragédie, la diffusion des images de caméras corporelles a déclenché un débat intense sur la responsabilité policière, la transparence, et sur la façon dont nous protégeons à la fois nos jeunes et nos agents.
J’ai passé les derniers jours à discuter avec des résidents de Parc-Extension, où l’incident s’est produit. Le quartier semble différent maintenant – plus silencieux, plus solennel. Plusieurs habitants secouent la tête, incrédules qu’une crise de santé mentale ait pu se terminer aussi tragiquement.
« Ça aurait pu être l’enfant de n’importe qui, » m’a confié Marie Desjardins devant le centre communautaire où une veillée a été organisée. « Quand quelqu’un est en crise, il a besoin d’aide, pas de confrontation. »
Les images des caméras corporelles, publiées par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) du Québec, montrent l’escalade rapide de la confrontation. En tant que journaliste qui couvre Montréal depuis près de vingt ans, j’ai vu évoluer la relation de notre ville avec le maintien de l’ordre, mais la transparence brute de cette vidéo représente quelque chose de nouveau pour le Québec.
Le SPVM a commencé son programme de caméras corporelles en 2019, avec une mise en œuvre complète déployée progressivement. Contrairement à plusieurs juridictions américaines où de telles images sont devenues monnaie courante, le Québec a avancé avec prudence, équilibrant les préoccupations de vie privée avec les demandes de responsabilisation.
Dr. Emmanuelle Bernheim de l’Université d’Ottawa, spécialiste du droit et des interventions en santé mentale, m’a expliqué pourquoi cette affaire représente un tournant. « Quand on voit l’interaction se dérouler en temps réel, ça change la conversation de politiques abstraites à des pratiques concrètes, » m’a-t-elle dit lors de notre conversation téléphonique hier.
Ces images ont poussé la mairesse Valérie Plante à demander une révision des protocoles policiers concernant les interventions en santé mentale. Lors d’une conférence de presse à laquelle j’ai assisté à l’Hôtel de Ville, elle a souligné que « nous devons nous assurer que les agents ont la formation et les ressources nécessaires pour désamorcer les situations impliquant des personnes vulnérables. »
Ce qui rend cette affaire particulièrement déchirante, c’est que la famille de Rezayi avait apparemment appelé à l’aide pendant une crise de santé mentale. Selon les voisins avec qui j’ai parlé, la famille était récemment arrivée à Montréal en quête de sécurité et d’un nouveau départ.
Les représentants du syndicat de police maintiennent que les agents ont suivi les protocoles établis face à une situation potentiellement dangereuse. Marc Lavalée, porte-parole de la Fraternité des policiers et policières de Montréal, a défendu les actions des agents lors d’un point presse. « Les agents prennent des décisions en une fraction de seconde dans des situations volatiles pour se protéger et protéger les autres, » a-t-il déclaré.
Cependant, les défenseurs de la santé mentale soutiennent que ces protocoles eux-mêmes nécessitent une reconsidération urgente. Sarah Clément, de la Coalition pour les droits en santé mentale du Québec, m’a confié lors de notre rencontre dans un café du Mile End que « nous continuons de traiter les crises de santé mentale comme des menaces criminelles plutôt que des urgences médicales. »
Le programme de caméras corporelles lui-même fait maintenant l’objet d’un examen renouvelé. Initialement salué comme un pas vers la transparence, des questions émergent sur l’utilisation des images, leur stockage, et quand elles devraient être rendues publiques.
Michel Juneau-Katsuya, expert en protection de la vie privée, estime que le Québec doit trouver son propre équilibre. « On ne peut pas simplement adopter les approches américaines concernant les caméras corporelles, » m’a-t-il expliqué lors de notre entretien dans son bureau au centre-ville. « Le cadre juridique et le contexte culturel québécois exigent une mise en œuvre réfléchie qui respecte la vie privée tout en garantissant la responsabilisation. »
À Parc-Extension, un quartier connu pour ses vibrantes communautés immigrantes, les résidents expriment à la fois tristesse et frustration. Fatima Rahman, organisatrice communautaire, m’a confié que « beaucoup de nouveaux Canadiens se sentent déjà hésitants à appeler les autorités. Cette tragédie approfondit cette peur. »
Hier, j’ai visité le mémorial grandissant près du lieu de l’incident. Des notes manuscrites en français, anglais, farsi et plusieurs autres langues entouraient les photographies du jeune Rezayi. Parmi les fleurs et les bougies, j’ai remarqué plusieurs messages écrits par des adolescents – un rappel que cette tragédie résonne profondément chez les jeunes Montréalais.
L’enquête du BEI se poursuit, avec des conclusions complètes attendues dans les prochains mois. Entre-temps, les leaders communautaires réclament des changements immédiats dans la façon dont la police répond aux crises de santé mentale.
Dr. Marcel Émond, médecin urgentiste et chercheur au CHU de Québec, préconise l’expansion des équipes mobiles d’intervention de crise. « Nous avons besoin de professionnels de la santé mentale comme premiers intervenants dans ces situations, » m’a-t-il dit. « La présence policière peut parfois aggraver plutôt que désamorcer une crise. »
Alors que Montréal va de l’avant, la conversation sur les caméras corporelles a évolué de la question de savoir si les agents devraient les porter à comment les images devraient éclairer les changements de politique. Cette tragédie pourrait finalement remodeler la façon dont notre ville aborde à la fois le maintien de l’ordre et l’intervention en santé mentale.
Les semaines à venir apporteront probablement des manifestations, des discussions politiques et des conversations communautaires douloureuses. Pour la famille de Nooran Rezayi, cependant, ces débats arrivent trop tard. Leur deuil privé est devenu un catalyseur public pour le changement – une responsabilité qu’ils n’ont jamais demandé à porter.
Pour ceux d’entre nous qui considèrent Montréal comme notre chez-nous, ce moment exige une réflexion honnête sur la façon dont nous protégeons nos plus vulnérables et sur ce que signifie vraiment la responsabilité dans le maintien de l’ordre moderne. Les images des caméras corporelles n’offrent pas de réponses faciles, mais elles nous empêchent de détourner le regard des questions difficiles.